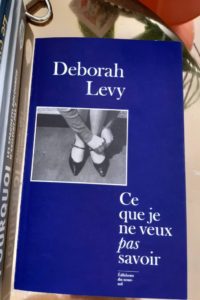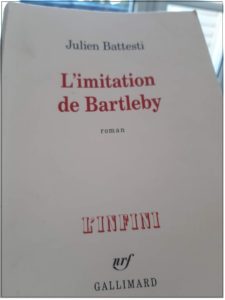Il y a quelque chose d’extrêmement touchant dans la manière qu’a le poète Pierre Vinclair d’aborder la fabrique du poème. Il y a chez lui cette conscience de la détermination réciproque de l’effort tendu – du don – et de sa réception.
Dans cet essai, Pierre Vinclair analyse rétrospectivement comment tous ses poèmes se sont formés, comment il a appris à les redresser, pour leur donner une « dignité » dans un effort tendu vers un lecteur donné. Après une période où il a dressé les axes d’un projet pour une résidence de Kyoto, il a appris à entrelacer les trajectoires déterministes et le hasard, à inviter les anachronismes dans son histoire, à dégager de sa succession de notes prises sur le vif une sonorité urbaine, dans un marché-crawlé dans les rues des grandes villes où s’activent les travailleurs transparents. Il fait danser ses phrases âpres en s’adressant à ses frères, en racontant une vie mangée par la laideur ; il est sans cesse interrompu dans ses gestes quotidiens par les gestes prosaïques des vies d’ailleurs.
Doté d’une conscience aigüe de l’importance de la réception d’une œuvre, du jeu qui se joue derrière cette réception, Pierre Vinclair n’aime pas flouer son public. Et, chose rare, il saisit pour vous toutes les étapes intermédiaires avant de tirer les fils du nœud final,
avant l’instant où les
« Mots, vers, strophes sonnets filent en dialectique
Le discret et le continu, cousent un rythme :
Une unité retient l’autre en figure, écho
Ouvert, puis clos à terme sur le mètre échu.
La prose a besoin d’un volcan pour sa lave
avance – et le poème est un carillonnage. »
( Sonnet 36 de « Sans adressse» )
Il vous donne ce que peut donner un poète de terrain. « Je dis que le poème est dressé, je pourrais dire redressé ― au même sens où on dit à quelqu’un d’avachi de se redresser pour la photo : le poème final n’est plus en coulisses comme sa version de carnet. Il pose dans l’espace public, il sait qu’on le regarde, il est sur scène. J’expliquerai dans un prochain chapitre la parenté que je lui trouve avec le rituel. » Et il illustre ce redressement par des exemples concrets, comment il reprend ses vers jetés sur le vif, concentre sa vision, comment « une forme apparaît peu à peu dans ce redressement, et dans cette forme le type de dire qui définit l’existence et la dignité du poème. Une nouvelle expérience prend alors le relais, qui se déploie cette fois dans l’attention, non au réel, mais aux possibilités de la langue. »
Pierre Vinclair raconte les crises qui l’ont fait, les amitiés qui l’ont nourri, les poèmes adressés. Les poètes qui ont jalonné son parcours, en particulier dans son investissement politico-poétique – Claude Pinson qu’il a invité dans la revue Catastrophes, d’où sont nés « La Sauvagerie » et « Agir non agir » parus l’an passé. Un passage traçant un rapide tour d’horizon du courant moderniste nous rappelle judicieusement que toutes les écoles de cette riche période, malgré les batailles de prises de pouvoir, nous ont légué un héritage qui « consiste essentiellement en un point, qui empêche de le restreindre à un courant, à savoir : le refus de faire du poème une activité séparée de la vie, qui consisterait, comme de la broderie, à orner par un recours à une rhétorique traditionnelle élaborée (avec ses rimes, ses strophes, etc.) des discours idéalistes ou édifiants. Mis à l’endroit, cette définition négative devient : le modernisme est une tentative de rendre compte de la vie par l’exploration formelle. »
La langue de Pierre Vinclair s’est nourrie entre la médiathèque de Nantes au rayon poésie qu’il a souvent fréquenté, la scansion rapide de lignes de rap écrites pendant son adolescence, la rigueur de sa formation scientifique (sans cesse une recherche de consistance, d’unicité, de définition d’une base de projection), sa formation philosophique, sa lecture assidue des objectivistes américains, son travail de thèse à travers l’œuvre de William Carlos Williams, Paterson, ses traductions du Chinois, du Japonais et de l’Anglais (lire à ce propos les très belles traductions de John Donne qu’il a récemment postées sur Catastrophes).
A l’heure où la parole se fait flot, ce livre est une belle invention. Parce que les fabriques à illusions prolifèrent. Pour illuminer une opacité entretenue, faire briller un déclaré Grand Ecrivain de quelques pages supplémentaires à la Sainte Beuve (grand-père, père, mère, la vie dure, voyez comme j’ai souffert… ) qui viendront compléter les photos des carnets étalés. Les traits tirés. Renforcer les postures. Il y a un vrai renversement de valeurs dans cet essai : Pierre Vinclair choisit d’installer la pérennité du geste poétique, le distribue à qui veut s’en saisir, relance la machine du poème. Tout est élan.
Je finirai par cette citation de mon cru : « Aujourd’hui, était dissipée l’obscurité qui divise les sexes et qui abrite, bien dissimulées, d’innombrables impuretés et, si ce que dit le poète de la vérité et de la beauté est vrai, la tendresse d’Orlando gagna en beauté ce qu’elle perdit en mensonge. » Virginia Woolf (traduction de Catherine P-Musard)
PS : On pourra compléter la lecture de « Vie du poème » par l’indispensable « Sans adresse », très beau recueil de sonnets qui revisite l’intime, s’accroche au monde à travers les tours de Shangaï, brise son propre élan par un sarcasme, avec un goût prononcé pour le Conceit, (a comparaison becomes a conceit when we are made to concede likeness while being strongly conscious of unlikeness, définition du Conceit par Margaret Llasera).