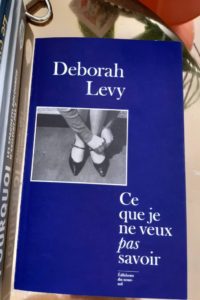Belinda Cannone qualifie de « phase de transition un moment où les conduites (comment on agit) et les représentations (comment on se figure les choses) ne coïncident pas. Ainsi défaisons-nous nos couples tout en rêvant d’amour éternel. La phase que nous traversons préfigure selon moi une nouvelle époque dans la conception du lien amoureux : je le nommerai du nouveau nom d’amour-désir. »
Et même si « l’amour est la réalité psychique la plus compliquée à comprendre », même si « l’amour est relation et donc à ce titre il est constamment soumis aux fluctuations des cœurs qui cherchent à s’ajuster », elle tente de dresser un « cadre général dans lequel nous le concevons et le vivons. »
Ce qui est intéressant ici, c’est qu’après être repassée par les mythes (le plus célèbre, celui du Banquet, la figure sphérique séparée, la recherche de la part manquante, l’évidence de l’amour « retrouvaille de l’être, à la fois autre et soi-même, dont on a été séparé et qui seul peut éveiller notre sentiment »), par l’étymologie des mots (Philia, l’amour paisible, Eros, l’amour comme désir, puissance qui s’empare d’un être pour le jeter vers un autre), Belinda Cannone s’arme d’outils, construit des mots-valises pour poursuivre son analyse et rendre au désir une place centrale, le débarrasser de sa mauvaise réputation. Elle tente de prouver que l’importance accordée au désir, cette aspiration qu’elle constate dans la société contemporaine, « cette disposition humaine digne d’être pensée pour elle-même, et honorée », permet de faire converger représentation et conduite au sein du couple contemporain. Elle construit son argumentaire en renversant des relations de causalité qu’elle transforme en relations de signification tout en élevant le désir (sa contrainte pour résoudre son problème de convergence représentation-conduite), ce thème qu’elle explore depuis toujours sous toutes ses formes ; le désir donc, raison de vivre, donnée anthropologique s’il faut en désigner une qui nous donne envie de nous lever le matin ; le désir ressort de cet essai avec une plus grande élasticité, profondeur, s’éloignant ainsi de son caractère pulsionnel plus souvent célébré.
Elle déploie son argumentaire en dialoguant avec une rousse, bisexuelle, Gabrielle. Après avoir expliqué que « depuis que le désir, dont la temporalité n’est pas celle de l’amour, est devenu un ingrédient important de la vie du couple, il en est devenu le problème », elle introduit ce qu’elle nomme l’amour-désir. « Philia n’est qu’une partie d’Eros, Eros diminué de la composante charnelle. L’amour, le grand amour, c’est Eros. Ce que j’appelle l’amour-désir. » Elle explique comment Eros et Philia se sont historiquement confrontés dans deux pôles opposés sans intersection aucune. Puis elle retrace l’histoire du « couple conjugal pour comprendre l’histoire de l’amour », raconte comment « l’identité personnelle contre l’appartenance au clan a émergé » (Shakespeare), retrace les étapes qui ont mené du mariage de raison au mariage d’amour, électif, une idée neuve : « La conception du couple, qui a toujours varié en fonction de la classe sociale d’appartenance, s’unifiera définitivement après la première guerre mondiale… dans la bourgeoisie, une « descente sociale » qui se caractérise, par exemple, par la disparition des serviteurs nombreux… l’élévation relative de la classe ouvrière : ainsi se constitue une importante « classe moyenne » dont le modèle, celui de la famille fondée sur le sentiment amoureux, l’intimité du foyer et la stricte répartition des rôles, se répand dans la société. » Elle énumère les importantes transformations des mentalités au 18ème siècle, l’exode rurale, la famille-cellule resserrée, le « roman et le roman-feuilleton atteignent un vaste public dont ils modifient à la longue l’imaginaire. », le divorce admis au 19ème, « d’où l’idée piquante que c’est le triomphe de l’amour qui assure celui du divorce, et que de la possibilité du divorce résulte la ruine de l’adultère. » Puis l’auteur développe l’idée qui nous semble aujourd’hui naturelle selon laquelle « l’histoire de la sexualité et celle des femmes se déchiffrent ensemble… mariage, désir, amour forment une structure dont les éléments sont interdépendants. La condition des femmes en fait partie. Elle évolue du même pas que les trois autres : une femme plus libre réclame qu’on entende son désir et qu’on honore son plaisir. »
« La littérature, dans un mouvement d’aller-retour, édifie et structure notre imaginaire amoureux, tout en contribuant à asseoir nos manières concrètes de vivre l’amour. » C’est bien sûr en repassant par les grands mythes, Tristan et Iseult, notre héritage littéraire : Maupassant, Balzac, Marivaux, Molière, Rousseau, Flaubert, Tolstoï, ce grand réservoir de nos représentations sur l’amour, puisque nous nous formons aussi en lisant des romans, que Belinda Cannone retrace l’histoire de nos représentations, les notions et valeurs morales dont on a hérité, celles qui sont périmées. Elle introduit la temporalité des notions qu’elle introduit, comprend quelles sont celles qui arrivent en fin de course quand les romans se multiplient sur un sujet donné : on signe ainsi les derniers instants d’une « notion expirante » .
On a envie de la suivre, Belinda Cannone, même quand certains passages nous semblent rapidement bouclés, parce qu’elle nous rappelle que « la question du désir a été trop souvent négligée dans la réflexion où il n’est traité que comme une conséquence de l’amour ou de l’instinct. Cette conception disqualifiante, déjà présente chez Platon et ardemment soutenue par les chrétiens, incite aujourd’hui encore à dévaloriser ou à minimiser l’amour-désir. »
« J’ai dit qu’au cours de l’histoire la conception de l’amour ne conditionnait pas les manières de faire couple mais en découlait. Ce n’est peut-être plus vrai… l’amour semble s’inventer en même temps que les formes d’union. » Après avoir observé les causes de la tension entre sentiment et désir dans le couple, Belinda Cannone s’intéresse à la temporalité du couple et introduit ce qu’elle nomme la polygamie lente. « La parentalité n’exige pas qu’on vive continûment avec ses enfants ; le mariage n’est qu’une des manières de faire couple, à côté du Pacs, du concubinage et même du together apart, comme dit une de mes amies qui habite à deux pâtés de maisons de son fiancé. » Elle affirme que viendra un temps où ces liaisons-déliaisons ne seront plus vues somme des échecs, mais comme la « respiration naturelle de la vie affective » même si « il existera sans doute toujours des unions « pour la vie »… un « nous » qui se déploie dans une rencontre continuée. C’est ce qu’il (le philosophe François Julien) nomme aussi « second amour » qui ouvre à une dimension d’infini. »
Dans cet essai, Belinda Cannone constate des situations, décrit de grands mouvements, et « défait » des idées (ou croyances) fermement ancrées. En particulier quand elle pointe le concept majeur du manque et l’idée de la vulnérabilité que ce manque engendre (Le mot désir dérive du latin desiderare qui signifie être face à l’absence d’étoile). « Dans les définitions, on trouve couramment l’idée, dichotomique, que « dans Eros, c’est le corps qui commande et pas la raison » ; comme si Eros n’était qu’une manifestation du corps, une de ses tocades, et comme si la psyché n’était pas convoquée par le désir. » Et même si l’on possède ce que l’on désire, il faut que l’amour dure (cet équilibre instable entre manque et puissance).
« Ainsi donc, le manque ne serait pas seulement lié au désir de ce qu’on n’a pas. Il se manifesterait aussi dans la volonté de posséder toujours. A Platon et ses émules je demande : est-ce mal de manquer ? Quel est le fantasme sous-jacent à cette dévalorisation du manque ? Celui de vivre l’existence du fœtus, douillettement à l’abri dans le liquide placentaire ? La beauté de notre condition n’est-t-elle pas au contraire de vivre constamment tendu vers autrui, vers la connaissance (notre manque à savoir), vers le cosmos et l’inconnu ? Nous sommes des êtres en mouvement et en relation, rien dans l’humain ne se conçoit, ne se comprend, n’est admirable hors de cette tension permanente vers l’altérité – ce qui nous manque et ce que nous désirons. Rechercher l’élargissement est notre vœu et sans doute notre grandeur, et il ne s’obtient que par la mobilité. Ce désir du non-manque me rappelle la facétieuse affichette placardée sur le mur d’un bureau où j’avais à faire : « Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine… Elle est mortelle. » Si vous pensez que le manque est douloureux, essayez l’ataraxie…
Le manque n’est pas ce qu’on croit. Contrairement à ce qu’affirme Socrate, le désir ne vient pas du manque mais du plein. Le manque conduit à la mélancolie : c’est le deuil jamais dépassé qui couvre de son ombre toute l’existence d’un sujet, ombre à laquelle celui-ci est attaché comme à sa plus sûre compagne. Le désir, lui, manifestation de l’énergie vitale, contient la promesse de la joie et, d’emblée, une forme d’accomplissement, dans la mesure où il nous fait éprouver pleinement notre participation au monde. Sommes-nous jamais si vivants que dans le désir ? » Après la lecture de ce passage, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec la littérature cocon, la littérature « qui fait du bien », ce continent littéraire qui grossit à la même vitesse que celui de l’autobiographie solipsiste, nombriliste. Et bien sûr, on pense également à cette quantité de romans ou chacun se soucie davantage de préserver son désir du manque que de le satisfaire, incessants allers-retours où le désir angoisse, provoque des positions de repli, frustrations, etc. Abondance, abondance de récits de ce type… Une notion qui expire ?
On pourra prolonger cette réflexion en lisant et écoutant le philosophe Fulcan Teisserenc pour qui la définition du désir n’est pas négative puisque le désir est fondamentalement intelligent au sens où c’est parce que nous avons du désir finalement, nous pensons.
Belinda Cannone appuie ainsi sur les verrous qui, selon elle, empêchent les représentations et conduites des couples de coïncider. Cet essai est particulièrement bienvenu à cette période où la structure de notre société se métamorphose considérablement. Précisons que l’auteur ne s’intéresse pas aux « nouvelles conduites amoureuses, des rencontres éphémères, de la sexualité de « consommation » favorisée par les réseaux sociaux, les sites de rencontres et les applications du type Tinder, de l’influence du capitalisme, d’une certaine façon « immature » de ne pas s’engager qui caractérisait une frange de la jeunesse… » Mais, elle tente de comprendre comment « le modèle de l’amour « pour toujours » dominant nos représentations depuis le mariage chrétien » confronte « l’injonction à vivre dans et avec le désir », et « pourquoi la plupart de ceux qui évoquent le couple en parlent d’un modèle en crise et soulignent ses difficultés. »
Une partie intéressante se penche sur l’inégalité considérable entre hommes et femmes qui existe encore en dehors du lit, dans notre façon de se mettre en relation, où la femme ne manifeste pas verbalement son désir en première. Bélinda Cannone rappelle également que l’érotisme est un langage et il me semble qu’elle aborde là un thème majeur trop souvent sous-estimé tant la recherche de l’égalité homme-femme nous en éloigne. « Tous les humains pratiquent d’une manière ou d’une autre, raffinée ou pas, ce langage, et l’on a tort de prétendre qu’il révèlerait notre animalité : au contraire, il en exprime le dépassement et représente une pratique civilisée par excellence. Il révèle notre sauvagerie – à ne pas confondre avec l’animalité – qui est liée au fait qu’il convoque d’autres parties de la psyché que la seule rationalité, mais c’est bien le corps-esprit tout entier qui s’engage dans l’étreinte – privilège hautement civilisé. » Elle relève judicieusement cette contradiction. « On pense souvent, comme à la fin du XIX siècle, quand naissait la science moderne, qu’il existerait un « instinct de reproduction » et on en conclut que l’activité sexuelle n’a pour but véritable que la perpétuation de l’espèce. Je me demande si l’on a bien mesuré les conséquences d’une pareille idée : si, cette finalité reproductrice était la raison sous-jacente de notre désir, on devrait considérer comme perverse ou déviante toute pratique autre que la copulation hétérosexuelle, et les femmes cesseraient toute activité sexuelle après quarante ans – lorsque ça devient vraiment formidable. Quant à cette nature qui nous commanderait de nous reproduire, on se demande pourquoi elle se montre silencieuse face à la catastrophe environnementale que – si dangereusement pour la perpétuation de l’espèce – nous sommes en train de créer. »
Un essai très intéressant qui laisse une part appréciable à l’intuition de l’auteur, sa foi inébranlable en l’énergie vitale du désir, puise dans un dialogue stimulant des questions qui éclaircissent le paysage, renverse des notions ancrées, héritées de nos représentations historiques, met l’emphase sur la structure culpabilisante de la société et de nos croyances.
Elle recentre les questions féministes dans un débat plus passionnant, émet des idées constructives. La grande force de cet essai réside dans le fait que Belinda Cannone relie l’amour et le désir entre eux en se penchant sur l’impensé. De plus, elle revêt l’amour dans le couple de son aspect naturellement et fondamentalement altruiste, et certainement est-ce une initiative heureuse dans l’état actuel de notre société férue d’amours malheureux . « L’amour-désir est reconnaissance et assomption de l’altérité. Il n’enlève rien à l’autre, ne le dépouille ni ne le diminue, et le plaisir réciproque lui confère une beauté supplémentaire ; ce désir en acte est création commune, comme une danse partagée, une œuvre à quatre mains, deux voix, deux corps – un accroissement de l’être. En ce sens, il se distingue de la pulsion sexuelle solipsiste : celle-ci, qui émane de moi-même, m’y reconduit au terme de son déploiement. »
Probablement est-ce naturel pour un écrivain d’assigner au désir le pouvoir absolu. En réalité, l’écrivain est, je crois, souvent poursuivi par une obsession (lire Faulkner, Olga Tokarczuk ou Virginia Woolf pour s’en convaincre). Or l’obsessionnel désire tous les matins (l’objet du désir est une recherche de vérité). Comme le répète Olga Tokarczuk, l’obsession a cela de bon, qu’elle concentre le travail en des séances de recherches approfondies. Quelques écrivains passent par cet état, lisant des dizaines de fois un livre qui les obsède, et y consacrent pleinement leur temps, parfois jusqu’à l’épuisement. Ou tournent toujours autour d’un même sujet. On se doute que la matière première qui émane du fond de l’inconscient depuis que la psychanalyse nous aide à établir des correspondances entre les différentes instances psychiques qui nous définissent est protéiforme. Tirer un fil encore et encore devient pour un écrivain une grande source de questionnement. Cet essai me permet de rebondir sur la question de l’écriture-amour-passion (obsessionnelle) ou de l’écriture-amour-désir qui chemine sur différents sujets et accouche de différents cycles. Après la lecture de cet essai, je me pose la question de l’interprétation que l’on peut avoir de l’obsession comme obstacle à dépasser. Est-ce que l’obsession et la créativité sont reliées par un principe de causalité ou une relation de signification, de connivence, l’une et l’autre étant étroitement liées. Par exemple, comment expliquerait-on qu’une obsession puisse être « dépassée » après la production d’un livre ? Est-ce qu’une œuvre se compose d’une ligne obsessionnelle et d’autres amours-écriture-désir ?
Affaire à suivre donc…
« Donnée anthropologique majeure : l’être humain aime. »
Corollaire 1 : Donnée anthropologique majeure : l’être vivant désire.
Corollaire 2 : Donnée anthropologique majeure : l’obsédé textuel doit écrire.
Le nouveau nom de l’amour ; Belinda Cannone ; Editions Stock ; septembre 2020.