Article paru dans Substack. Réflexion sur l’écriture, la littérature, l’édition, la politique, les zones d’ombre entre démocratie et royauté d’expression, l’idéologie dominante.
Auteur/autrice : lapagederita
Fumer du crack avec Lovecraft
Article paru dans Substack. Réflexion autour d’un texte de Lovecraft. Décoller d’une réalité figée, associer au mouvement de la pensée un univers imaginaire, une spatialité non objective, viser un monde en expansion en transitant par un état de confusion poétique.
Vertige des chutes avec l’artiste new-yorkais Norman B. Colp
Article paru dans Substack à propos le flot des commuters à NYC depuis la pandémie.
Charles III ne viendra pas cette semaine
Article paru dans Substack qui décrypte l’état de notre système de santé dans le contexte social actuel.
Lumière
De pierre polie, l’escalier
hisse nos ombres, assemble
nos corps jusqu’au vestibule
clos. Coulisse
la porte silencieuse
d’où le Miracle d’Or
inverse la nuit
noire.
Les gardiens glissent sur les parois
escortés par une armée de lucioles,
me disent que depuis toujours, se joignent
aux hommes une étoile.
Les trésors d’ivresse,
coupe de vin de Jahangir
et ses versets mystiques de jade
néphrite, calligraphie arabe,
cristaux minuscules de pierre dure,
poussière d’or jetée depuis les lumières
persanes et ces figures aux yeux impérieux
de la taille d’un doigt dont les iris irradient
toutes les ombres devenues UNE.
La sculpture blanche sortie
de la main d’un artiste, à
4500 ans d’ici, disent-ils, si loin ?
Mains sur les seins, corps animé de la
taille d’une paume, courbure épurée blanche
immaculée, Modigliani en 2500 avant J.-C. ?
Le jade fécond, une renaissance précisent-ils,
et l’obsidienne des yeux
scrutant les étoiles millénaires comme les gardiens,
ressurgissent
« Les sources d’émerveillement de nos ancêtres préhistoriques »
de L’enfance de Parker
me dit que depuis
toujours, toujours le geste
protège ce qui s’offre à
la paume, et la paume rassasiée descend
le long de la corde de velours du
lustre, rejoint le monde d’en bas
et le ciel quadrillé de cette
lumière,
gardienne de nos pas.
Poème écrit à la suite de la visite de la collection Al Thani de l’Hôtel de la Marine
Présentation vidéo de L’enfance de Parker
Présentation en grand format : https://www.instagram.com/p/CijocULtdpq/
Présentation en petit format :
Interview avec Loïc Barrière au sujet de « L’enfance de Parker » sur Radio Orient
Interview menée par Justine Rocher (lectrice de Babelio) à l’occasion de la sortie de l’enfance de Parker
Question : Qu’est ce qui a initié l’écriture de ce livre, comment l’idée t’est-elle venue ?
Rita des Roziers : Pour être honnête, je voulais écrire quelque chose de léger, de fantaisiste et de réconfortant. Et finalement l’histoire de l’enfance de Parker s’est révélée plus profonde qu’elle n’en a l’air. A la surface, ce livre accueille le lecteur dans une atmosphère chaude, à l’intérieur d’une bibliothèque vivante desservie par l’élégant couloir d’une grande demeure anglaise. Derrière les rideaux de velours, des rôtis luisants se dressent sur une nappe provençale. Et à l’extérieur, dans le jardin, des fougères entre les arbres accrochent la lumière, dissimulent une veste coupable et un amour contrarié.
Mais quand on écarte les feuilles de fougères, que l’on soulève la nappe ou enfile la veste coupable, il se passe des choses.
Question : Est-ce que tu peux me décrire ton livre en quelques mots ?
R dR : L’enfance de Parker est l’histoire d’une crise familiale. C’est un livre qui raconte la fugue d’une jeune archéologue Virginia qui abandonne la région prospère du Sud de la Grande Bretagne, amant, meilleure amie, frère et sœur, et part à la poursuite d’un vestige enfoui dans les landes du Nord.
Question : Comment as-tu structuré ton livre et pourquoi as-tu décidé que le narrateur serait le majordome ?
R dR : Cette fugue est en effet racontée par le majordome. Je voulais un narrateur extérieur aux préoccupations de Virginia. Il me semblait qu’il était préférable d’excentrer le point de vue, même si c’est Virginia et Frizzy qui me sont apparues le plus clairement quand j’ai démarré cet ouvrage. Et je voulais surtout un personnage loin des idéaux de la bouillonnante Virginia. Un moi social opposé. Je n’étais pas forcément consciente à ce moment-là de tous ces choix, mais je pense que j’avais besoin de m’inscrire contre la domination du « Je », ce moi de l’auteur qui offre rarement un livre de portée universelle, et qui épuise notre capacité d’imagination, organe primordial. L’imagination est un organe et non une idée abstraite. Je pense qu’elle se travaille, qu’elle contribue à installer l’auteur au centre d’un processus qui entraîne son cerveau à acquérir une certaine élasticité, lui permet de transgresser les normes, de bousculer les interprétations automatiques que les récits normatifs répètent sans cesse. C’est un organe qui permet de modifier notre perception de l’expérience et donc notre regard sur le monde.
Question : D’où la citation d’Olga Tokarczuk en exergue ?
R dR : Tout à fait. « Nous observons, mesdames et messieurs que le « moi » humain s’hypertrophie, devient de plus en plus distinct et présent. Par le passé, le « moi » était discret, avait tendance à s’éclipser, à rester soumis au collectif. […] » Le moi soumis au collectif, donc. Je crois en la nécessité de transformer notre littérature pour qu’elle renoue avec notre existence réelle, qu’elle fasse entendre le battement de nos pas affolées par tous les fléaux du monde actuel, rongé par l’individualisme, l’appât du gain, l’argent-roi. Il ne suffit pas de désigner ces fléaux et de lire des essais pertinents sur le sujet pour les combattre. Il faut aussi transformer notre manière d’agir.
Nous sommes normalement libres de nos actes dans nos contrées occidentales, mais la « liberté » a un drôle de sens aujourd’hui. D’ailleurs on constatera que même quand les gens sont libres de voter, ils ne votent pas. La liberté est une vague notion galvaudée. Et on a complètement oublié qu’elle n’est pas seulement jouissance individuelle, mais une notion soumise au collectif. Il faut s’imaginer le monde aujourd’hui comme une énorme toile avec une foule de pions qui s’entrechoquent et réclament un espace de liberté. Les réseaux sociaux nous le démontrent tous les jours. De plus, la liberté de chacun est corrélée à sa propre indépendance financière, or notre société n’a jamais été aussi inégalitaire. Ce qui crée le climat réseau-sociétal que l’on connaît. Pour être libre de nos propres mouvements et se mouvoir sans cogner l’autre, il faut aussi que cet autre ait un espace où vivre, une voix qui vive, une pensée qui puisse se déployer, se heurter à celle d’autrui, s’y confronter.
Question : Pourquoi as-tu situé ton récit dans la région du Hopeshire en 56 ?
R dR : Nous avons vécu une période terrible. Souvenons-nous de l’hécatombe au début de la pandémie. Et nous entrons dans une période de guerre sociale et climatique. Les armes ne sont plus les mêmes. Les victimes, les morts sont plus difficiles à voir. Ils occupent un espace de moins en moins facile à délimiter. Ce ne sont pas des corps étendus criblés de balles. Et j’ai naturellement repris les thèmes qui me préoccupent aujourd’hui : la parole partagée, la distance sociale, l’incompréhension. L’intimité selon le milieu social, le mode de vie. La catharsis par l’expression artistique. Et aussi le rituel, le geste quotidien. Le geste de la main.
Le temps et l’espace définissent un socle, l’histoire se situe en 56 mais en réalité, les thèmes traités dans « L’enfance de Parker » sont universels.
Question : A quoi correspond le plumeau magique auquel tu fais référence en quatrième de couverture ? Y a-t-il un symbole derrière ?
R dR : Oui, le monde du plumeau magique est un monde où l’on interroge nos peurs, peur de la mort, peur de basculer dans un monde nouveau, peur de ne pas se sentir utile, peur d’être jugé, de ne pas être aimé. C’est un instrument simple d’utilisation pour un homme muni d’une main qui en quelque sorte réfléchit et sonde les profondeurs de son âme.
Question : Tu te situes en quatrième de couverture dans le droite ligne du modernisme. Peux-tu développer ? Te sens-tu rattachée à ce courant littéraire ?
R dR : Non, je ne me sens rattachée à aucun courant. Ce qui me constitue est propre à mon histoire, à l’époque dans laquelle je vis, à mes crises personnelles, ma curiosité, à mon appétit de lecture. Ensuite, l’écriture telle que je l’aime et la défend, c’est celle qui rend au lecteur son pouvoir de lecteur, d’interprète. Ce pouvoir lui est régulièrement confisqué par un marketing toujours plus bruyant. Le trajet que l’on construit depuis son propre foyer imaginaire pour rencontrer et interpréter la parole de l’autre est un pèlerinage. C’est comme cela que se construit une littérature que l’on espère universelle, un texte qui agit sur notre perception. Quand j’écris un livre, j’en ressors transformée. Je souhaite qu’il en soit ainsi pour le lecteur.
Si je devais situer mon écriture – actuellement, parce qu’évidemment cela pourrait changer dans l’avenir –, j’écris comme une portraitiste. Je m’attache à donner vie à mes personnages tels qu’ils s’offrent à moi sur le plan diégétique, en scrutant leurs gestes, en sondant leur intimité à travers leurs agissements. Cela provient probablement de mon éducation orientale.
Et pour revenir au modernisme ou aux modernismes, j’y fais référence surtout pour insister sur l’intimité que je sonde, avec le souci d’établir un lien avec l’autre. Avec les autres cultures. Le modernisme a touché tous les arts au début du siècle dernier et a modifié notre rapport au réel. C’est un courant qui s’est développé avec toutes les répercussions que l’on connaît à un moment de crise dans notre société. Et nous sommes à un moment de crise profonde où je pense que les récits nombrilistes n’ont plus de place. Où notre mode de vie guidé par les lois du marketing a engendré une société fortement individualisée, avec une dictature de l’évènementiel dans le monde des livres affolante qui ne peut plus alimenter nos becs affamés de sens, avides d’établir une nouvelle façon d’être au monde, avides d’agir sur le cours de nos pas.
Question : Quel conseil donnerais-tu à tout écrivain débutant ?
R dR : Il faut sceller un pacte avec le Dieu du sommeil. Il faut croire en son pouvoir, lui offrir son corps endolori, s’absoudre de tout. Et il faut écouter son corps qui reçoit le bruit du monde.
Question : Et un conseil plus pratique ?
R dR : Beaucoup lire. Et surtout bien lire. Je crois en la transformation du corps, en la capacité du corps-esprit bien nourri de produire un texte nourrissant – se transformer tout en restant soi. Chacun doit trouver sa voie. Je suis une lectrice qui aime beaucoup relire. Et chaque relecture m’apporte un angle de vue différent. J’essaie également d’écrire des textes avec plusieurs clefs de lecture, les réécris encore et encore. Plusieurs dizaines de fois. Je n’aime pas le jetable. Je lis essentiellement de la littérature traduite, anglaise et russe. Un peu de littérature française. Si je devais décrire une particularité qui m’est propre : j’écris toujours la première et la dernière phrase dans un même élan. Même si je ne sais pas où je vais, quel chemin je vais emprunter. Je n’atterris pas forcément sur cette phrase à la fin, mais elle se retrouve en dernière page. Et puis je fais confiance à la première page qui, si elle est conduite sans effet de manche pour « accrocher » le lecteur, enracine un texte qui se déploie avec une croissance organique, biologique et sans engrais.
Question : Tu es présente depuis longtemps sur Twitter. Que t’apporte cette présence et penses-tu que ce média apporte quelque chose à la littérature.
R dR : Oui, je le pense. Evidemment, Twitter me permet d’établir des liens avec mes lecteurs. Mais je n’ai pas que des retours de lectures sur mes textes et je ne propose pas que des angles de lecture sur d’autres textes : j’ai aussi des lecteurs-contributeurs réguliers qui sont devenus des amis et m’aident quand je cherche des références, m’intéresse à un sujet particulier. J’informe mon réseau de mes lectures en cours, des perles que je déniche, de mes sujets de recherche. Je pioche des idées de lecture. Depuis mon site personnel où poésie, critiques et chroniques se répondent et s’interrogent, je poste des liens. Ces contributions d’apparence disjointes, en réalité se nourrissent mutuellement. Par exemple dans « Le petit lion » où j’invoque Mandelstam et écris-voyage entre trois pôles.
Je parle également souvent de peinture. La peinture catalyse ma créativité et me permet de traverser cette frontière étonnante entre représentation désirante et production artistique. Par exemple dans ce texte où je parcours les allées du jardin de Monet, me fait balloter entre les vagues de Woolf tout en m’interrogeant sur mon rapport à l’écriture. Il en ressort que la composition de mes personnages est centrale et je le vois bien dans mes textes.
Question : Deux mots sur la littérature contemporaine, son avenir ?
R dR : Quel est le défi de la littérature contemporaine ? Je pense que le défi pour chacun est de rapprocher, de créer des liens entre ce qui n’a pas de lien, ceux qui n’ont pas de liens. Les réseaux ont pris une telle importance dans notre vie, qu’ils nous ont bien malgré nous formatés dans ce sens. La littérature contemporaine doit trouver un moyen de traduire notre monde actuel avec une grille de lecture pleine de singularités saillantes.
Interview menée par Justine Rocher @LaccrochePlume.
Parution de l’Enfance de Parker
Par ici –> https://amazon.fr/dp/B0B3BH6T3V/

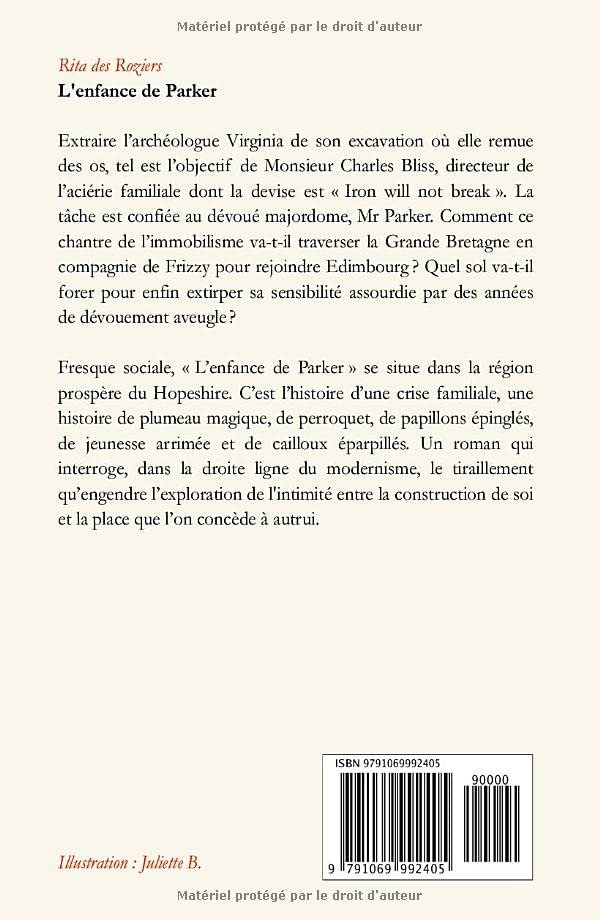
Le petit lion
Voici venu le temps des plis intérieurs, pavots frissonnants, et tout au fond un petit point doré d’où surgit écumant de vie l’horizon de blé. Le blanc du ciel fabrique une pluie de confettis. Et sous chacun de nos pieds, précisément là où l’on se tient, le chant des oiseaux rabattu par le froid, comme autant de petits cristaux de roche creusée par la grâce d’un bec. L’hiver dans nos tanières et ses bûches n’ont pas dit leur dernier mot. Le givre a fendu les commissures des fenêtres ; s’attardant sur les étendues d’herbes jaunies, il enlace des bulles de sons racornis.
Oubliée la chaleur du sable.
Oublié le crâne qui divague.
oublié
Un vêtement rouge frôle le sol sur un pas de danse.
Sous un givre à peine luisant, plusieurs graines cuisent leurs dernières substances : elles comptent leurs réserves – de la folie ordonnée, un peu d’illusion, beaucoup de croyances –, débrident un œil, concoctent une percée soudaine.
Un petit lion m’accompagne depuis que je l’ai sorti d’une brocante où il tournait en rond comme un vagabond. Contre toute attente, une fois relié à ma table de travail, il a gardé son étiquette, majestueux avec son prix au juste poids : deux petites billes humides qui fondent sous mon pouce, le col moelleux, le poil doux – on s’y logerait. Je l’ai installé sur une branche d’olivier trouvée à Saint-Rémy, noueuse, d’une patine centenaire. L’ai entouré de mousse. Quelques fruits ramassés. Cette nature exubérante autour remplit la pièce d’un bruissement de savane, gueules affamées, roues crissant sur parterre de cailloux saturés.
La longue tyrannie
du voyage désiré, désir sans fin, bruit d’une route où la quête suit son chemin, soudaine arborescence à droite à gauche, pendant que les doigts courent sur les deux billes d’une taille de demi-grain.
Il y a un temps, c’était les minuscules coquillages emplis des vagues de l’autre continent que je roulais sous un pouce. La fabrique des souvenirs n’avait alors pas ce rugissement du lion affamé. Elle avait la voix d’une espèce attentive à cet âge où la main recueille les grains, raffolait du long rassemblement de la vague, incessant d’une rive à l’autre, se logeant dans le lobe. Le lobe où elle répandait ce son qui extirpe du Sens, avale d’un coup d’eau les interminables Songes, goûte à la certitude d’être
simplement
un de ces rares temps où la rumination se suspend au bruit du temps.
Présence en lévitation sans rien pour distraire l’air qui soulève.
Puis le petit lion a fait son apparition, et la fabrique à souvenirs a étoffé sa musique, a rajouté des coups de tambour. BOUM! Elle s’est enfouie dans une brèche, fouillant au plus profond – Le temps se fend en dynasties et en siècles, Mandelstam – boum ! a hissé mes songes sur un sentier où jamais pieds n’avaient risqué s’enfoncer. A gonflé de prescience animale le vent derrière comme devinant que les flèches maudites s’aiguisaient. L’homme traqué court dans le royaume des mots – Un morceau de citron, c’est un billet pour la Sicile, Mandelstam.
Il est difficile de savoir aujourd’hui si la machine à souvenirs a tracté cette histoire que je raconte, si les évènements tractent la machine. Pourquoi les faire coïncider ? Maintenir chacun à son plus haut, comme une injonction, un art de vivre, une idée de ce que serait la littérature :
L’imagination,
l’histoire.
Et ce que l’on vit.
Ce grand voyage entre les trois pôles, pour que chacun culmine à son plus haut. Comme saute-ruisseau, ma conscience a deux ou trois petits mots : « Et voici que », « déjà », « soudain », Mandelstam.